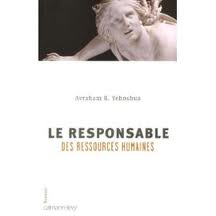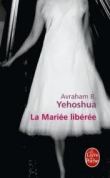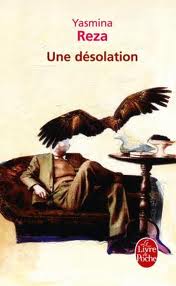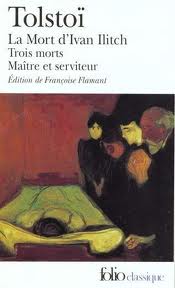« Une vie de lapin le jour de l’ouverture de la chasse ».
Voilà comment un jeune poilu résumait pragmatiquement la situation dans une lettre écrite à la fin du mois d’octobre 1914, depuis la région de Verdun. Et en un sens, tout est dit ici du dernier roman de Jean Echenoz, 14 (éditions de Minuit, 124 pages, 12,50€), paru à la dernière rentrée littéraire. Beaucoup de bêtes, quelques hommes, et un choix narratif tel qu’on ne sait, bien souvent, plus très bien distinguer les uns des autres, dans cette pathétique boucherie où chair à canon, poux, rats, chevaux et absence à soi-même s’entremêlent par la grâce d’un élégant ballet d’écriture. Mais pouvait-il en être autrement avec l’auteur fétiche des Editions de Minuit ?
 On est en 1914, entre la Vendée et les tranchées. On est dans l’attente, on est dans l’ennui. Atomes de soupirs pour les femmes, fragments de stupeur pour les hommes. No man’s land du front, campagne atone de l’arrière. Et premiers biplans d’observation, aussi, minuscules moustiques perdus haut au-dessus de ces terres hagardes. C’est la caméra d’Echenoz qui décide. Avec une minutie tantôt repliée, tantôt ramifiée, celle-ci prend son envol juste avant la sonnerie du tocsin annonciateur de la mobilisation générale, en ce vaporeux samedi 1er août 1914, puis, plus tard, au gré des mois, elle plongera, sillonnera, frôlera, s’arrêtera variablement auprès des menus personnages, dessinés dès l’incipit – et pour ainsi dire une fois pour toutes – en quelques traits de crayon magistralement imprécis. Subsisteront d’ineffables détails pour faire exister cinq hommes et une femme.
On est en 1914, entre la Vendée et les tranchées. On est dans l’attente, on est dans l’ennui. Atomes de soupirs pour les femmes, fragments de stupeur pour les hommes. No man’s land du front, campagne atone de l’arrière. Et premiers biplans d’observation, aussi, minuscules moustiques perdus haut au-dessus de ces terres hagardes. C’est la caméra d’Echenoz qui décide. Avec une minutie tantôt repliée, tantôt ramifiée, celle-ci prend son envol juste avant la sonnerie du tocsin annonciateur de la mobilisation générale, en ce vaporeux samedi 1er août 1914, puis, plus tard, au gré des mois, elle plongera, sillonnera, frôlera, s’arrêtera variablement auprès des menus personnages, dessinés dès l’incipit – et pour ainsi dire une fois pour toutes – en quelques traits de crayon magistralement imprécis. Subsisteront d’ineffables détails pour faire exister cinq hommes et une femme.
Anthime, Bossis, Padioleau, Arcenel et Charles sont tous liés indistinctement les uns aux autres, et tous partent dans la guerre, certains avec des capotes trop grandes et un chaos d’outillages, d’autres portant placidement moustache, monocle, appareil photo Rêve Idéal et discours troupier. La falote Blanche est fiancée à l’un d’eux, peut-être amoureuse d’un autre. Mains comme éternellement croisées sur le ventre, sur le manche d’un parapluie ou la hampe d’une poussette, elle patiente bientôt dans une ville de femmes, d’enfants et de vieillards, grave et fermée. Et des uns aux autres, l’oeil du narrateur transite, implacable, doucement étranger à ce qui est déjà arrivé depuis si longtemps. Regards laconiques, échanges brefs, gestes impénétrables, désabusement général d’un peuple qui attend, alangui à l’arrière ou éparpillé au front. Mais n’exister que dans la nébuleuse attente, d’une victoire, d’un salut ou d’un effacement littéraire, suffit-il pour exister dans l’imaginaire du lecteur ?
C’est bien l’ennui avec cette brillante et froide technique d’écriture échenozienne, lorsqu’elle est poussée à son absolue maîtrise. Entre vocation du détachement et jouissance évidente du détail pictural, 14 trahit presque la cause qu’elle défend, se perdant dans une succession de tableaux à l’esthétique parfaite mais atrophiée de toute émotion et de toute tension véritable, si l’on excepte l’étrange effet des quelques saillies douces-amères du narrateur, bien présent lui dans notre époque. Car le vrai sujet du court roman d’Echenoz, au fond c’est celui-là : l’écriture calibrée au millimètre, fluide, précise, parfaite, pétrie de désuétudes soignées et rythmée comme un chant las. On assiste à l’inventaire précis et incomparablement orchestré des lieux, des objets, des silhouettes et des bêtes donc. Toutes les bêtes possibles. Depuis le singe en conserve jusqu’aux colombidés militarisés. Les bêtes comestibles et les bêtes guerrières, amenées dans l’incompréhensible chorégraphie qui s’étire, s’engourdit, s’accélère ou se suspend au gré des pages noires et blanches, sur une bande-son étrangement étouffée, assourdie. A la merci du narrateur, nous sommes forcés à une plongée brève et dense dans la France du début de siècle, provinciale et un peu simplette sur les bords, mal dégrossie, mal préparée, celle quittant le monde d’hier sans être encore dans celui de demain, celle d’un entre-deux abruti qui n’en finit plus de ne pas crever une bonne fois. Plongée aussi, bien sûr, dans la guerre, enfin moderne.
 Timidement moderne toutefois, maladroitement, laborieusement. Car nous sommes ici dans cette fameuse première guerre des hommes du progrès, pathétiques pantins sans nom ensevelis sous des rideaux de feu et d’acier, se débattant stupidement dans leur attirail chatoyant : cervelières enveloppantes, baïonnettes brillantes, pantalon rouge garance, képi bleu ciel. Première guerre des hommes du progrès dont on sait déjà à peu près tout au fond, dont a saisi l’inanité complète et monstrueuse par les témoignages des fantassins rescapés et autres gueules cassées qui se déversèrent ensuite, avec des mots bousculés, des images pathétiques, un torrent d’exclamations coupées, tâtonnant vers un langage nouveau et juste qui devait trouver enfin sa sobre expression une génération plus tard. Mais non plus seulement dans la bouche des combattants en uniforme, au contraire… Cet angle-là, qui n’eût pas été inintéressant – montrer les balbutiements d’une langue s’ouvrant sur l’indicible – ne trouve prise nulle part dans ce roman se voulant pourtant distancié et finalement subtilement empathique. Non 14 décidément ne traite que de 14. Boues, tranchées, bras qui sautent et chevaux qui crèvent. Départs nombreux et retours faméliques. Stupeur et effondrements. Continuité de l’histoire.
Timidement moderne toutefois, maladroitement, laborieusement. Car nous sommes ici dans cette fameuse première guerre des hommes du progrès, pathétiques pantins sans nom ensevelis sous des rideaux de feu et d’acier, se débattant stupidement dans leur attirail chatoyant : cervelières enveloppantes, baïonnettes brillantes, pantalon rouge garance, képi bleu ciel. Première guerre des hommes du progrès dont on sait déjà à peu près tout au fond, dont a saisi l’inanité complète et monstrueuse par les témoignages des fantassins rescapés et autres gueules cassées qui se déversèrent ensuite, avec des mots bousculés, des images pathétiques, un torrent d’exclamations coupées, tâtonnant vers un langage nouveau et juste qui devait trouver enfin sa sobre expression une génération plus tard. Mais non plus seulement dans la bouche des combattants en uniforme, au contraire… Cet angle-là, qui n’eût pas été inintéressant – montrer les balbutiements d’une langue s’ouvrant sur l’indicible – ne trouve prise nulle part dans ce roman se voulant pourtant distancié et finalement subtilement empathique. Non 14 décidément ne traite que de 14. Boues, tranchées, bras qui sautent et chevaux qui crèvent. Départs nombreux et retours faméliques. Stupeur et effondrements. Continuité de l’histoire.
Sibylline derrière le décor nourri et léché, l’intrigue, quant à elle, tient bel et bien en trois lignes, celles qui sont dépliées sur la quatrième de couverture : Cinq hommes sont partis à la guerre, une femme attend le retour de deux d’entre eux. Reste à savoir s’ils vont revenir. Quand et dans quel état.
On eût voulu goûter nous aussi les quinze magistrales séquences offertes avec ces questions, parmi d’autres, en matrice. Peine perdue, le destin des uns et des autres se comprend finalement comme un traître artifice narratif. Et les vies de papier se révèlent un bien fluet fil rouge nous conduisant à cette stupéfiante révélation en même temps que le narrateur nous le susurre indistinctement : la guerre, quelle connerie. Avec quelques superbes images, soigneusement articulées, l’écriture d’Echenoz sauve néanmoins autant qu’elle enterre, et on retiendra notamment la plus courte scène d’amour jamais écrite : « Il s’est couché près d’elle et l’a prise dans son bras, puis il l’a pénétrée avant de l’inséminer. » Surprenant.
Avraham ‘Boolie’ Yehoshua
Depuis une trentaine d’années, Avraham B. Yehoshua, 77 ans, est, aux côtés de ses amis Amos Oz et David Grossman, l’une des figures de proue de la littérature hébraïque contemporaine.
Auteur israélien prolifique révélé au début des années 1960 par la publication de premières nouvelles, il ne cesse ensuite de multiplier les formes d’écriture, avec le souci constant de renouveler son approche stylistique, mêlant les dialogues à une seule voix et les ruptures de regards pour faire surgir du texte la vérité de ses personnages, et à travers elle les fractures intimes et les interrogations existentielles des Juifs israéliens d’aujourd’hui.
Un examen perpétuel de l’âme israélienne. Artiste fécond, il s’essaie récurremment au théâtre, nouvelles, critiques et essais. Mais c’est avec le roman qu’il s’impose en voix emblématique et accède à la reconnaissance internationale, devenant un dramaturge primé, salué, étudié et lu partout dans le monde. Écrivain des fêlures et des rapprochements incertains, il y explore avec une lucidité inquiète mais jamais tragique les tensions, les méfiances et les espérances insatisfaites éprouvées par des hommes et des femmes en quête d’identité, dont les amours, les accomplissements et les rapports à l’autre restent perpétuellement à conquérir dans un pays livré à l’instabilité et à la peur. Déroulant la trame de ses fictions avec un réalisme simple et délicat, ancrant les revirements de rythme narratifs dans la complexité fondamentale et profuse de son pays, Yehoshua dessine des vies ordinaires, juives et arabes, entrecroisées et entrechoquées à la faveur des événements, mais toujours animées d’une détermination obstinée. Torturés par des questionnements intimes et des interrogations existentielles parfois laissées sans réponse, ses personnages se trouvent confrontés à des situations singulières dont ils ressortent ébréchés mais plus clairvoyants. Récompensé du prix Bialik en 1989, du prix Israël en 1995 et du prix Médicis étranger en 2012 pour « Rétrospective », Yehoshua s’est fait, au fil des années, l’ambassadeur disert et vigoureux de la nouvelle génération d’auteurs israéliens.
Icône du camp de la paix et israélien engagé. Issu (en 1936) d’une famille juive sépharade installée en Israël depuis cinq générations, et cependant esprit laïc foncièrement rationnel, Yehoshua s’est aussi illustré dans l’espace public en prenant inlassablement la parole et la plume pour agir en faveur de la paix. Il s’affirme ainsi en intellectuel israélien très engagé et en conscience morale d’envergure dans son pays. Militant aussi actif qu’infatigable d’un dialogue israélo-palestinien et pionnier du mouvement pacifiste Shalom Akhshav (La paix maintenant) qu’il fonde en 1978, ce sioniste de gauche condamne fermement la politique de colonisation, catastrophique pour les deux peuples, et plaide tenacement pour la création d’un Etat Palestinien, seule solution, à ses yeux, à même d’éviter la transformation irrésistible d’Israël en un Etat binational d’apartheid où la majorité de la population serait palestinienne (les taux de natalité étant très différents entre Arabes et Juifs), et qui à terme aboutirait à la désagrégation de la culture juive et à la disparition de l’Etat Juif, lançant une nouvelle fois son peuple dans l’exil (la galout) et la diaspora (la gola).
Avec sa silhouette trapue, sa force de conviction peu commune et son esprit vif et pétillant, Avraham Yehoshua a su renouveler la pensée intellectuelle israélienne sans jamais ni la trahir ni l’obscurcir. Il a participé largement à la revitalisation de la langue hébraïque et reste guidé dans chacune de ses interventions par un amour viscéral pour son pays, sa culture et son peuple. A l’automne 2012, à la suite des bombardements tirés depuis Gaza (dont Israël s’est entièrement retiré en septembre 2005) sur les villes du sud d’Israël, Yehoshua se prononce pour une intervention armée contre le Hamas.
Il vit aujourd’hui à Haïfa, ville la plus tolérante d’Israël et enseigne à la littérature comparée à l’université de Haïfa. Sa femme Rivka est psychanalyste.
Oeuvres majeures : Trois jours et un enfant (1975), Pour une normalité juive (1980), Monsieur Mani (1990), La mariée libérée (2003), Israël : un examen moral (2005).
Anecdote : Grand amoureux de la langue française qu’il parle couramment quoique avec une pointe d’accent chantonnant, A.B. Yehoshua a vécu à Paris de 1963 à 1967, présidant alors l’Union mondiale des étudiants juifs. En juin 2007, invité par l’Institut français de Tel Aviv, il y débat avec le journaliste et écrivain français Pierre Assouline sur l’identité juive, la complémentarité des cultures et l’histoire d’Israël. C’est au détour de la discussion qu’il lance un sentiment personnel reflétant assez justement tant la complexité profonde d’un pays construit sur le principe d’immigration légitime mais avec des natifs à l’histoire distincte que le complexe de culpabilité insoluble du vieux peuple juif d’Israël qui n’a connu la Shoah que par les postes de TSF et les journaux, et auquel Yehoshua appartient malgré lui : » La grande erreur du peuple juif a été de ne pas rejoindre en masse la Palestine en 1917 au lendemain de la déclaration Balfour. Il n’aurait pas seulement aidé à créer plus tôt l’Etat d’Israël : il aurait échappé à l’Holocauste. Les signes du danger imminent s’accumulaient et malgré cela il a refusé la révolution sioniste. En choisissant de rester dans l’exil, de même qu’il avait choisi l’exil depuis des siècles car les Nations ne le lui avaient pas imposé, le peuple juif est devenu moralement co-responsable de ce qui lui arrivé pendant la guerre. » Chaos dans l’assistance naturellement. Mais au-delà, mise en exergue des blessures éternelles et de la stupeur morale absolue que continue de générer l’Holocauste.
A ce sujet, lire l’excellent « Connaissance et culpabilité : les Juifs de Palestine face à l’extermination des Juifs en Europe » de Idith Zertal, historienne et journaliste israélienne.
PAGE 99, EXTRAIT
Le responsable des ressources humaines (2005)
279 pages
– synopsis –
Attentat suicide sur un marché de Jérusalem. Une femme est tuée. Sur la victime, un unique document : sa feuille de paie, qui porte comme seule référence le nom d’une société. A l’hôpital, personne ne vient réclamer son corps. Un journaliste tente de déclencher un scandale en dénonçant le « manque d’humanité » de l’entreprise, qui ne s’est même pas inquiétée de l’absence de son employée. Mais qui est donc cette inconnue ?
Sur l’ordre de son patron, c’est le jeune responsable des ressources humaines qui se lance sur ses traces. Peu à peu, l’image de cette femme s’insinue en lui et l’obsède…
Il découvrit une sorte de vieille momie desséchée et barbue aux traits encore reconnaissables. Les yeux hermétiquement clos témoignaient de l’âpre bataille que l’homme avait dû livrer contre la mort un an auparavant. Son visage portait encore les stigmates de la souffrance qui, depuis lors, s’était peut-être un peu atténuée dans le coeur de ses proches. Emmitouflé d’un lourd manteau d’hiver, le DRH frissonna et fourra ses mains gantées dans ses poches.
» On devrait venir ici de temps à autre pour remettre les pendules à l’heure et comprendre ce qui est vraiment essentiel à la vie « , commenta-t-il, fataliste.
Le technicien opina du chef.
» Oui, et surtout ce qui ne l’est pas. »
Le DRH remarqua que la peau du cadavre ressemblait à un parchemin jaune vif. Sa poitrine ressemblait à un vieux livre sacré dévoilant quelques pages.
» C’est intéressant… « , répéta-t-il.
Il considéra le technicien, qui avait l’air très satisfait, et lui demanda s’il était croyant. L’autre répondit que non, tout en admettant qu’il y avait des moments où l’on était bien obligé d’avoir la foi si l’on ne voulait pas oublier son humanité quand on préparait les cadavres, au moment où se retiraient les derniers vestiges de vie.
Le temps avançait à la grosse horloge murale. Après une pareille expérience, on ne pourrait vraiment plus accuser le DRH d’être impressionnable. Il s’apprêtait à franchir la porte quand il s’immobilisa soudain et demanda où se trouvait son ex-employée qui, crut-il bon de préciser, était ingénieure en mécanique.
Elle n’était pas là. Juste derrière, il y avait un petit local réfrigéré. Se serait-il décidé à l’identifier, finalement ?
Avraham ‘Boolie’ Yehoshua
Depuis une trentaine d’années, Avraham B. Yehoshua, 77 ans, est, aux côtés de ses amis Amos Oz et David Grossman, l’une des figures de proue de la littérature hébraïque contemporaine.
Auteur israélien prolifique révélé au début des années 1960 par la publication de premières nouvelles ébauchées pendant son service militaire, il ne cesse ensuite de multiplier les formes d’écriture, avec le souci constant de renouveler son approche stylistique, mêlant les dialogues à une seule voix et les ruptures de regards pour faire surgir du texte la vérité de ses personnages. Et à travers elle, les fractures intimes et les interrogations existentielles des Juifs israéliens d’aujourd’hui.
Un examen perpétuel de l’âme israélienne. Artiste fécond, il s’essaie récurremment au théâtre, nouvelles, critiques et essais. Mais c’est avec le roman qu’il s’impose en voix emblématique et accède à la reconnaissance internationale, devenant un dramaturge primé, salué, étudié et lu partout dans le monde. Écrivain des fêlures et des rapprochements incertains, il y explore avec une lucidité inquiète mais jamais tragique les tensions, les méfiances et les espérances insatisfaites éprouvées par des hommes et des femmes en quête d’identité, dont les amours, les accomplissements et les rapports à l’autre restent perpétuellement à conquérir dans un pays livré à l’instabilité et à la peur. Déroulant la trame de ses fictions avec un réalisme simple et délicat, ancrant les revirements de rythme narratifs dans la complexité fondamentale et profuse de son pays, Yehoshua dessine des vies ordinaires, juives et arabes, entrecroisées et entrechoquées à la faveur des événements, mais toujours animées d’une détermination obstinée. Torturés par des questionnements intimes et des interrogations existentielles parfois laissées sans réponse, ses personnages se trouvent confrontés à des situations singulières dont ils ressortent ébréchés mais plus clairvoyants. Récompensé du prix Bialik en 1989, du prix Israël en 1995 et du prix Médicis étranger en 2012 pour « Rétrospective », Yehoshua s’est fait, au fil des années, l’ambassadeur disert et vigoureux de la nouvelle génération d’auteurs israéliens.
Icône du camp de la paix et israélien engagé. Issu (en 1936) d’une famille juive sépharade installée en Israël depuis cinq générations, et cependant esprit laïc foncièrement rationnel, Yehoshua s’est aussi illustré dans l’espace public en prenant inlassablement la parole et la plume pour agir en faveur de la paix. Il s’affirme ainsi en intellectuel israélien très engagé et en conscience morale d’envergure dans son pays. Militant aussi actif qu’infatigable d’un dialogue israélo-palestinien et pionnier du mouvement pacifiste Shalom Akhshav (La paix maintenant) qu’il fonde en 1978, ce sioniste de gauche a, notamment, condamné très tôt la politique de colonisation, catastrophique pour les deux peuples, et plaide tenacement pour la création d’un Etat Palestinien, seule solution, à ses yeux, à même d’éviter la transformation irrésistible d’Israël en un Etat binational d’apartheid où la majorité de la population serait palestinienne (les taux de natalité étant très différents entre Arabes et Juifs), et qui à terme aboutirait à la désagrégation de la culture juive et à la disparition de l’Etat Juif, lançant une nouvelle fois son peuple dans l’exil (la galout) et la diaspora (la gola).
Avec sa silhouette trapue, sa force de conviction peu commune et son esprit vif et pétillant, Avraham Yehoshua a su renouveler la pensée intellectuelle israélienne sans jamais ni la trahir ni l’obscurcir. Il a participé largement à la revitalisation de la langue hébraïque et reste guidé dans chacune de ses interventions publiques par un amour viscéral pour son pays, sa culture et son peuple. A l’automne 2012, à la suite des bombardements tirés depuis Gaza (dont Israël s’est entièrement retiré en septembre 2005) sur les villes du sud d’Israël, Yehoshua se prononce pour une intervention armée contre le Hamas.
Il vit aujourd’hui à Haïfa, ville la plus tolérante d’Israël et enseigne à la littérature comparée à l’université de Haïfa. Sa femme Rivka est psychanalyste.
Oeuvres majeures : Trois jours et un enfant (1975), Pour une normalité juive (1980), Monsieur Mani (1990), La mariée libérée (2003), Israël : un examen moral (2005).
Anecdote : Grand amoureux de la langue française qu’il parle couramment quoique avec une pointe d’accent chantonnant, A.B. Yehoshua a vécu à Paris de 1963 à 1967, présidant alors l’Union mondiale des étudiants juifs. En juin 2007, invité par l’Institut français de Tel Aviv, il y débat avec le journaliste et écrivain français Pierre Assouline sur l’identité juive, la complémentarité des cultures et l’histoire d’Israël. C’est au détour de la discussion qu’il lance un sentiment personnel reflétant assez justement tant la complexité profonde d’un pays construit sur le principe d’immigration légitime mais avec des natifs à l’histoire distincte que le complexe de culpabilité insoluble du vieux peuple juif d’Israël qui n’a connu la Shoah que par les postes de TSF et les journaux, et auquel Yehoshua appartient malgré lui : » La grande erreur du peuple juif a été de ne pas rejoindre en masse la Palestine en 1917 au lendemain de la déclaration Balfour. Il n’aurait pas seulement aidé à créer plus tôt l’Etat d’Israël : il aurait échappé à l’Holocauste. Les signes du danger imminent s’accumulaient et malgré cela il a refusé la révolution sioniste. En choisissant de rester dans l’exil, de même qu’il avait choisi l’exil depuis des siècles car les Nations ne le lui avaient pas imposé, le peuple juif est devenu moralement co-responsable de ce qui lui arrivé pendant la guerre. » Chaos dans l’assistance naturellement. Mais au-delà, mise en exergue des blessures éternelles et de la stupeur morale absolue que continue de générer l’Holocauste.
A ce sujet, lire l’excellent « Connaissance et culpabilité : les Juifs de Palestine face à l’extermination des Juifs en Europe » de Idith Zertal, historienne et journaliste israélienne.
PAGE 99, EXTRAIT
La mariée libérée (2003)
984 pages
– synopsis –
Yohanan Rivline, membre du département d’études moyen-orientales de l’université de Haïfa, est convaincu que le divorce de son fils Ofer cache un secret. Il y a plus de cinq ans que sa femme Galia l’a répudié et Ofer n’a toujours pas surmonté son chagrin. Ignorant le calme et la sagesse de son épouse Haguit, Rivline est incapable de supporter la douleur de son fils. Et quand il apprend la mort soudaine du père de Galia, il en profite pour reprendre contact avec la famille de son ex-belle-fille. Commencent alors visites et enquêtes dans la propriété du défunt, un hôtel à Jérusalem.
En nous guidant au cœur de l’histoire d’une famille, A.B. Yehoshua explore les désirs et les sentiments enfouis des âmes. La mariée libéré est aussi une saisissante allégorie du destin de deux peuples, et confirme la maîtrise narrative et poétique de l’auteur, un des romanciers majeurs de la littérature mondiale.
(…) Vous nous avez causé un chagrin immense, pas tant à cause de la brutale séparation imposée à Ofer – c’était votre droit – mais par votre fuite, votre manière d’éviter de nous dire adieu et de nous expliquer, à nous aussi, et avec franchise, les raisons qui vous avaient amenée à détruire un mariage que nous considérions à tort comme heureux. »
Elle se trouble et sa main retombe.
« Même si c’est vrai, reconnaît-elle dans un murmure, et à supposer que j’aie effectivement préféré vous éviter vers la fin, c’était peut-être justement à cause de l’amitié et de la confiance qui régnaient entre nous depuis le premier jour. Je ne pouvais rien vous dire. Non parce que je n’avais rien à dire, mais parce que je ne pouvais même pas le mettre en mots.
– Je ne comprends pas…
– Mais Ofer vous a sûrement dit quelque chose.
– Non. Rien de précis. Rien qui permette de se faire une idée… »
Elle paraît soudain très soulagée et rougit, bouleversée.
« Dans ce cas, c’est qu’il avait certainement une bonne raison de ne pas parler.
– Pas du tout, proteste le père de tout son cœur, ce n’était pas parce qu’il cherchait à cacher quelque chose ou à éviter la confrontation, c’était parce que lui non plus n’a jamais vraiment compris, j’en suis certain, ce qui vous a poussée à imposer cette brutale séparation, sans aucun signe préalable.
– Sans aucun signe préalable (elle sourit, moqueuse), est-ce que c’est possible ?
– Il y aurait donc des signes ?
– Bien entendu. Comment aurait-il pu en être autrement ?
 Casque bouclé posé sur un minois charmant, regard sage de normalienne et rondeur poupine de la jeunesse heureuse, Alice Zeniter, 27 ans dont une bonne partie passée dans la côte de Grâce, n’est pas un mauvais choix pour l’attribution du Prix du Livre Inter 2013, si l’on s’en tient à de strictes considérations marketing.
Casque bouclé posé sur un minois charmant, regard sage de normalienne et rondeur poupine de la jeunesse heureuse, Alice Zeniter, 27 ans dont une bonne partie passée dans la côte de Grâce, n’est pas un mauvais choix pour l’attribution du Prix du Livre Inter 2013, si l’on s’en tient à de strictes considérations marketing.
Quant à ses qualités de plume, force est de reconnaître que nous risquons de devoir nous y pencher d’un peu plus près dans les temps prochains. Non qu’on l’ait résolument boudée jusqu’à présent, mais ses deux précédents romans manquaient peut-être d’un petit quelque chose pour émerger significativement du flot perpétuel des œuvres de librairie.
Son premier livre, Deux moins un égal zéro, écrit d’une traite (normande ?) à 16 ans et publié par la confidentielle maison d’édition nantaise Petit Véhicule, souffrait par ailleurs, soyons honnêtes d’une couverture intéressante. Au moins aussi intéressante que le titre, pour être plus précis. Les premiers pas ne sont jamais faciles, c’est entendu. C’est donc avec beaucoup de bienveillance que nous pouvons considérer la suite, car la fable, charmante sans doute, demeure difficile à trouver jusque dans son synopsis et nous oblige à rester sur cette poétique du baptême.
Jusque dans nos bras (Albin Michel, 2010) fut une tentative déjà plus mature, plus considérée, plus vendue certainement aussi (ce qui, laissons-nous aller à cette taquinerie, ne devait pas être difficile). Ne serait-ce qu’en raison de la maison d’édition, solide, et évidemment de la couverture, qui, répétons-le, n’est pas un moindre détail même pour le lecteur le mieux intentionné. Absolument. Cette fois-ci donc, sobre, la couverture. Sobre, élégante et sérieuse. Le cœur du récit pourrait en revanche s’attirer de la part de certains quelques menus reproches de mièvrerie et d’humanisme bon marché enrobés d’un soupçon de sensationnalisme, puisque l’époque était alors au débat identitaire et le sujet facile. Chez d’autres, la délicate et ô combien sincère esquisse (de l’aveu de l’auteur) pourrait provoquer des attendrissements compréhensifs et des encouragements charitables. Le quatrième de couverture se présente ainsi :
« Je suis de la génération qui a fêté ses dix ans avec le génocide rwandais, je suis de la génération qui a perdu Bertrand Cantat et découvert la Lituanie par la même occasion, je suis de la génération qui n’aura plus de pétrole alors qu’elle commence à peine à s’amuser avec les low-cost, je suis de la génération qui ne peut pas accueillir toute la misère du monde. »
Aujourd’hui Alice se marie avec Mad. Mad est malien. Ils sont les meilleurs amis du monde depuis leur enfance, ils ont partagé le même bac à sable, le même collège et le même lycée, ils se sont enthousiasmés, engagés et révoltés, ils ont grandi ensemble, envers et contre tous.Aujourd’hui Alice se marie avec Mad. Mais leur mariage est un mariage blanc. Parce que c’est la seule chose qu’Alice peut faire pour sauver son ami, parce que ce sera la pierre de touche de son engagement, le point final de son adolescence.
Ouf.
A quoi n’avons-nous échappé sans le savoir…
 Nous jugerons donc les promesses de la jeune plume sur son dernier enfantement : Sombre Dimanche (Albin Michel, 283 pages), déjà salué par le Prix de la Closerie des Lilas 2013, et récompensé cette année par un jury de choc, au détriment du Goncourt 2009 Marie NDyae (pour Ladavine, Gallimard, 416 pages) et du tempétueux Olivier Adam (Les Lisières, Flammarion, 453 pages). La jeune femme aura pu patiner sa patte et son propos pour livrer un roman digne de ce nom qui calera idéalement le tube de crème solaire cet été et nous donnera bonne conscience, la plongée s’annonçant corsée, tout de même : « Les Mandy habitent de génération en génération la même maison en bois posée au bord des rails près de la gare Nyugati à Budapest. Le jeune Imre grandit dans un univers mélancolique de non-dits et de secrets où Staline est toujours tenu pour responsable des malheurs de la famille. Même après l’effondrement de l’URSS, qui fait entrer dans la vie d’Imre les sex-shops, une jeune Allemande et une certaine idée de l’Ouest et d’un bonheur qui n’est pas pour lui. »
Nous jugerons donc les promesses de la jeune plume sur son dernier enfantement : Sombre Dimanche (Albin Michel, 283 pages), déjà salué par le Prix de la Closerie des Lilas 2013, et récompensé cette année par un jury de choc, au détriment du Goncourt 2009 Marie NDyae (pour Ladavine, Gallimard, 416 pages) et du tempétueux Olivier Adam (Les Lisières, Flammarion, 453 pages). La jeune femme aura pu patiner sa patte et son propos pour livrer un roman digne de ce nom qui calera idéalement le tube de crème solaire cet été et nous donnera bonne conscience, la plongée s’annonçant corsée, tout de même : « Les Mandy habitent de génération en génération la même maison en bois posée au bord des rails près de la gare Nyugati à Budapest. Le jeune Imre grandit dans un univers mélancolique de non-dits et de secrets où Staline est toujours tenu pour responsable des malheurs de la famille. Même après l’effondrement de l’URSS, qui fait entrer dans la vie d’Imre les sex-shops, une jeune Allemande et une certaine idée de l’Ouest et d’un bonheur qui n’est pas pour lui. »
Agnès Desarthe
Normalienne agrégée et romancière primée, Agnès Desarthe (née à Paris en 1966) est l’écrivain des non-dits, des détails ineffables et des amitiés décousues. D’une plume à la profondeur toujours discrète, sensible et empathique, elle esquisse des histoires lumineuses, simples et fragmentées qui savent toucher à l’essentiel.
Lauréate du Prix du Livre Inter pour son deuxième roman (Un secret sans importance) et prix Goncourt des animaux pour son dernier roman (Une partie de chasse), elle est également une traductrice reconnue (arabe, russe et yiddish), une critique remarquable (collaboration avec France Inter) et l’auteur de nombreux livres pour enfants.
Anecdote : « Il arrive fréquemment que l’on demande à l’auteur pour la jeunesse que je suis de citer un livre qui a marqué son enfance. A cette question, je suis tentée de répondre : aucun. Il n’y avait pas de livre dans mon enfance. Il n’y avait pas de place pour ça. Je détestais lire, vous comprenez ? » Agnès Desarthe
PAGE 99, EXTRAIT
 Cinq photos de ma femme, d’Agnès Desarthe (1998)
Cinq photos de ma femme, d’Agnès Desarthe (1998)
– Synopsis –
La femme de Max Opass est morte il y a un an, et son visage hante celui qui partagea sa vie durant cinquante années. Max décide de fixer sur la toile ces traits qui l’obsèdent. Il retrouve cinq photographies datant d’époques différentes, et part à la recherche du peintre capable de reproduire la petite lumière des yeux de Telma… Mais était-il lui-même capable de décrypter ce regard ?
(…) – Expérimenté, répéta Max.
La lumière se fit en lui. Il ricana, d’un air énigmatique. Frédéric était un hippy, comme Basile. Max n’aurait su dire précisément ce qui fondait cette fraternité ; un mélange de flou et de technicité, une certaine hauteur alliée à une grande fragilité. Les deux garçons avaient de nombreux points communs ; tout d’abord cette manière si négligée de s’habiller ; ils parlaient beaucoup de travail et assez peu d’eux-mêmes, tenaient l’arrogance pour une qualité supérieure de franchise, taisaient leurs opinions pour s’en remettre à des slogans.
– Alors c’est d’accord ? avait demandé Frédéric.
Pour donner plus de poids à la requête de son ami, Marion était tombée à genoux devant Max, joignant les mains.
– C’est d’accord, dit Max. Les hippies ça me connaît.
– Les quoi ?
– Marion, je compte sur vous, dit Max pour toute réponse.
La jeune fille s’était redressée et avait frappé dans la main que lui tendait le vieil homme.
– Marché conclu.
Ils s’étaient quittés alors que le soleil commençait à décliner. Max se sentait léger. Il se trouvait incroyablement débrouillard et considérait que ses affaires allaient pour le mieux. Et puis il aimait bien ce couple qui n’en était pas un. Le garçon boudeur, la fille grandiloquente. Les jeunes femmes modernes étaient fascinantes. Elles passaient aisément de la tape dans le dos au battement de cils, des grandes enjambées de débardeur à la main qui remet délicatement en place une bretelle de soutien-gorge. Elles étaient la synthèse de tout ce qu’il avait connu, plus autre chose (…)
Bruno Bettelheim (Vienne 1903 – Etats-Unis, 1990)
Rescapé des camps de Dachau et de Buchenwald où il fut interné pendant onze mois en raison de sa confession juive, le psychanaliste Bruno Bettelheim, formé à l’Ecole de Vienne, se réfugie aux Etats-Unis quelques semaines après sa libération, en mai 1939. Quatre mois plus tard, un décret interdira toute sortie légale du Reich aux hommes juifs de 18 à 45 ans. Ses analyses du phénomène concentrationnaire restent reçues avec scepticisme jusqu’en 1945, date à laquelle le général Eisenhower fait distribuer l’un de ses rapports à tous les officiers américains stationnés en Europe.
Bruno Bettelheim a enseigné à l’université de Chicago et fut le directeur de l’Ecole orthogénique pour enfants perturbés de Chicago de 1947 à 1973. Au cours de sa prolifique carrière, il s’intéresse particulièrement au concept d’angoisse par le biais de ses réflexions et analyses sur l’expérience concentrationnaire et les relations parents-enfants.
Peu après la mort de sa femme, il se suicide le 13 mars 1990, à 86 ans, en s’asphyxiant dans un sac en plastique.
Anecdote : En 1998, Richard Pollack, le frère aîné d’un autiste soigné par Bruno Bettleheim, publie une biographie très polémique : The creation of Dr B.: a biography of Bruno Bettelheim (traduite en français en 2003 sous le titre « Bruno Bettelheim ou la fabrication d’un mythe ») , dans laquelle il dépeint le psychanalyste comme un pur mythomane et un mystificateur brutal et despotique. Ces affirmations ont été fermement contestées par la communauté scientifique. Bettelheim reste considéré comme un pionnier brillant et incontournable.
Oeuvres majeures : Le coeur conscient (1972) ; La forteresse vide (1967) ; Psychanalyse des contes de fées (1976).
EXTRAIT, PAGE 99
Psychanalyse des contes de fées, de Bruno Bettelheim (1976)
(…) Cette imprécision voulue exprime de façon symbolique que nous quittons le monde concret de la réalité quotidienne. Les vieux châteaux, les cavernes profondes, les chambres closes où il est interdit d’entrer, les forêts impénétrables suggèrent qu’on va nous révéler quelque chose qui, normalement, nous est caché, tandis que le « Il y a de cela bien longtemps » implique que nous allons connaître des événements des plus archaïques.
Les frères Grimm ne pouvaient pas ouvrir le recueil de contes avec une phrase plus révélatrice que celle qui introduit leur première histoire : « Le Roi-Grenouille ». Elle commence ainsi : « Dans l’ancien temps, quand les désirs s’exauçaient encore, vivait un roi dont les filles étaient toutes très jolies ; mais la cadette était si belle que le soleil, qui a pourtant vu tant de choses, s’émerveillait aussi souvent qu’il lui éclairait le visage. » Ce commencement situe l’histoire à une époque qui n’appartient qu’aux contes de fées : une période archaïque où nous pensions tous que nos désirs pouvaient, sinon soulever des montagnes, du moins changer notre destin ; et où, dans notre vue animiste du monde, le soleil s’intéressait à nous et réagissait aux événements. La beauté surnaturelle de l’enfant, l’efficacité du désir, l’étonnement du soleil expriment l’unicité absolue de l’événement. Telles sont les coordonnées qui situent l’histoire non pas dans l’espace et dans le temps d’une réalité extérieure, mais dans un état d’esprit ; celui d’un jeune esprit. Comme c’est là qu’il est situé, le conte de fées peut cultiver ce jeune esprit beaucoup mieux que ne peut le faire tout autre genre de littérature.
Bientôt surviennent des événements qui montrent que la logique et la causalité sont suspendues, comme il est vrai pour nos processus inconscients où n’arrivent que les événements les plus anciens, les plus uniques, les plus surprenants. Le contenu de l’inconscient est à la fois le plus caché et le plus familier, le plus obscur et le plus contraignant ; et il engendre l’angoisse la plus farouche (…)
Extrait, page 99
Une désolation, de Yasmina Reza (1999)q
– Je n’aime pas votre ton, monsieur. – Fench, a dit Léo. – Je me fous de votre nom, s’est énervé Hauvette, je me fous de qui vous êtes, je n’apprécie ni votre ton, ni votre effet sur Geneviève. – Monsieur Ôvette, a dit Léo dont la modération s’effritait, si vous êtes amateur de cette répugnante complication qu’on appelle une liaison, je vous recommande madame Abramovitz, je vous recommande vivement madame Abramovitz, a dit Léo qui s’échauffait et comme Hauvette ne lâchait pas la poignée de la portière, il est ressorti de la voiture, madame Abramovitz, a dit Léo en toisant Hauvette qui entre parenthèses avait une tête de plus que lui, est un être docile, farouche, caressant et prompt à trahir, elle possède tout ce petit fourre-tout de qualités contradictoires qui vous lie par le plus bas, on ne vanterait pas autrement, notez, un bon animal domestique. – Geneviève, veux-tu que j’intervienne ? s’est insurgé Hauvette. – Madame Abramovitz aime les hommes autoritaires mon vieux, intervenez donc sans demander la permission.
 S’il est une figure qui nous fait tous hurler d’effroi lorsqu’on la croise au détour d’une page, c’est bien celle du vieux. Plus éprouvant pour nos nerfs que le plus machiavélique des tueurs en série, plus imprévisible que le plus névrosé des héros, plus increvable que son propre narrateur. Donnez-moi un vieux, dans un roman, n’importe lequel pourvu qu’il ait une tête de hibou et le dessus des mains fripé, et je vous promets votre dose d’horreur jusqu’à la fin du livre.
S’il est une figure qui nous fait tous hurler d’effroi lorsqu’on la croise au détour d’une page, c’est bien celle du vieux. Plus éprouvant pour nos nerfs que le plus machiavélique des tueurs en série, plus imprévisible que le plus névrosé des héros, plus increvable que son propre narrateur. Donnez-moi un vieux, dans un roman, n’importe lequel pourvu qu’il ait une tête de hibou et le dessus des mains fripé, et je vous promets votre dose d’horreur jusqu’à la fin du livre.
Car nous le savons bien ; surgi d’on ne sait où pour on ne sait quelle raison, le vieux n’est jamais innocent, jamais là par hasard. Les yeux luisants par-dessous des sourcils neigeux, le sourire toujours en coin tiré par une ride louche, notre croulant attend son heure tandis que sa silhouette d’encre s’enracine doucement dans le paysage.
A petits coups, toujours, c’est comme ça que le carnage s’annonce. Ainsi, à une page où on ne l’attend pas, le vieux déboule, sécateurs à la main ou regard plissé sur ses pensées, avec l’air d’en avoir vu. Il ressemble à n’importe quel grabataire rencontré dans la vraie vie : modérément bavard, gentiment lointain, définitivement libre de son temps. Vieux renard. Trente pages plus loin, le voilà qui réapparaît, l’air déjà indiciblement plus leste, la parole plus fielleuse, le museau plus vif. Le monstre. Parfois, il tient même le rôle principal, et l’auteur, inconscient, se laisse emmener vers le massacre sans se rendre compte. En prenant son vieux par la main, viens ô fragile créature, je suis l’auteur, je vais te faire vivre, viens esprit ridé, tu as souffert, je le vois, laisse-moi t’embrasser. Et puis, pan, un coup de pelle à tarte dans le dos, et c’en est fini pour l’auteur. Le vieux prend les commandes. Ça va bien les bécots, tu m’as pris pour quoi ? Un caniche de concours ? Le roman se transforme en polar atroce ; les yorkshire à barrette fantaisie y mâchonnent une oreille dans un coin de salon, les pots de sucre se remplissent d’arsenic, les réunions d’anciens se transforment en meetings façon Klu Klux Klan des dentiers en colère. A mort les héros ! Dehors les belles histoires ! On va vous faire voir, bande de crétins ! Y a des fidèles de Guillaume Musso qui vont en cracher leur bougie au muguet, on peut vous dire !
Seigneur, mais imaginez un instant cette scène d’apocalypse : réunis dans une même œuvre, l’implacable juge Wargrave des Dix petits nègres (Agatha Christie,1939), la fine Renée de l’Élégance du hérisson (Muriel Barbery, 2006), Limonov le moujik magnifique ressuscité d’entre les mourants par Emmanuel Carrère (Limonov, 2011), Josef Fritzl de Claustria (Régis Jauffret, 2012), épouvantable fou, inspiré de Josef Fritzl, d’Amstetten, vedette des palais de Justice… Et puis tous les autres, les gros calibres bien connus qui hantent la réalité des librairies depuis des années, parfois des siècles, sans faillir : la Cousine Bette, vieille fille increvable (Honoré de Balzac, 1846), Ulysse, chic type pas commode sur la fin (Homère, IXème siècle av. J-C), Humbert Humbert, poète pédophile (Vladimir Nabokov, 1955), Barbe-bleue, tueur en série n’ayant jamais surmonté la crise de la quarantaine (Charles Perrault, 1697), Cathy Trask, putain irrespectueuse et détraquée confirmée (John Steinbeck, 1952)… Enfin, la liste est longue. Non, c’est vrai, je vous mets au défi de trouver un livre sans un vieux quelque part, prêt à faire un mauvais coup, qui polit les fourches dans le noir et crache en douce dans les géraniums comme un bagnard en pleine forme. Même grand-papa Joe (Roald Dahl, 1964), je ne l’ai jamais trouvé très clair. Je le voyais allongé dans son lit avec les trois autres impotents et je frémissais. Un type qui trouve rigolo de respirer des odeurs de pieds toute la journée, je regrette, c’est un type qui a un grain, il faut se méfier.
Comme disait Boris Vian, « les vieux, il faudrait les tuer dès la naissance ». Dans les livres, entendons-nous bien. Dans les livres. Que les retraités reposent immédiatement leur couteau à beurre, tout va bien les amis ! Là, un bonbon au miel et on n’en parle plus. Les vieux, dans les livres, sont redoutables. Parfois, par un étrange tour de passe-passe, la fiction rejoint la réalité, mais c’est une autre histoire. Et au sommet de la chaîne alimentaire, royaux, inoxydables, imperturbables, il y a : les Pater Familias. Espèce mutante d’une férocité et d’une astuce sans égales. De vrais tueurs. Qui vous pétrifient le derrière d’un coup de sourcil et vous demandent si la lumière n’est pas trop forte pendant qu’ils vous plaquent la lampe à aveux dans les pupilles : « Mon chéri, je ne serai pas en colère si tu me dis la vérité. Tu m’as menti, hier, je le sais. Raconte-moi ce qui s’est passé. Tu es mon enfant, ma progéniture, ma chair. Je t’écoute, mon amour. Parle-moi. » Un conseil, arrangez-vous pour ne jamais en arriver là. Parce qu’une fois ce palier atteint, vous êtes plus cuit qu’un gigot de sept heures. Hervé Bazin et Jules Vallès en savaient quelque chose. Le Sagouin de François Mauriac le sentait aussi, du bout de ses neurones ramollies par les coups de bambou. Encore que, soulignons-le, il n’y avait pas trop de « Mon chéri » dans leur vie de papier, ô misérables, innocentes victimes.
Les vieux sont des monstres, et c’est peu de le dire. Ils cumulent la perfidie d’un Iago à la nonchalance d’un Caligula. Ils ont la voix fragile mais les idées compactes. Les bras flasques mais les doigts agiles. Et les patriarches, suprêmes tyrans passés maîtres dans l’art de la dictature de velours, agissent le rictus aux lèvres, conscients de leur intouchable statut. Jugez plutôt cette confidence d’un doyen parmi les plus résolus : « On ne peut tout seul garder la foi en soi-même. Il faut que nous ayons un témoin de notre force : quelqu’un qui marque les coups, qui compte les points, qui nous couronne au jour de la récompense. » (Le nœud de vipères, François Mauriac, 1932). Si ce n’est pas l’aveu d’une guerre secrète sournoise et décidée ! Et celle-là, la Génitrix : « Mais regarde-toi donc, mon petit : il faut être ta mère pour te supporter. Voilà cinquante ans que je te tiens tête, moi, ta mère, et je me demande comment je suis encore vie. » Je ne sais pas vous, mais moi quand je lis ça, ça me donne envie d’aller claquer 300€ dans une paire de chaussures. Et de rentrer en taxi. Pour bien la faire chier.
 Et donc, émergeant dans ce petit monde charmant, voilà le roman de Yasmina Reza, Une désolation, dense bijou délicieusement ciselé, publié en 1999, ce qui fait déjà un bail et nous place idéalement dans le sujet.
Et donc, émergeant dans ce petit monde charmant, voilà le roman de Yasmina Reza, Une désolation, dense bijou délicieusement ciselé, publié en 1999, ce qui fait déjà un bail et nous place idéalement dans le sujet.
Cent cinquante-six pages, un monologue serré, intelligent et drôle comme une bulle de savon, dans lequel défile un va-et-vient incessant de souvenirs d’une percutante concision et d’une jubilatoire narration, entre quelques soupirs désolés et des persiflages réjouissants. Toute une multitude de scénettes, de tranches de vies justes et cruelles brossées avec une douceur irrésistible par le héros, Samuel Perlman. Nouveau nom qui ne démérite pas, décidément, dans le bestiaire des vieux.
Car c’est bien lui la terrible tête d’affiche, Samuel Perlman, vieil homme féru de jardinage et de sarcasmes tranchants comme des sécateurs. Notre narrateur à cheveux blancs n’est cependant pas là pour regarder pousser les fleurs. A 73 ans, « cerné par les heureux », accablé par la vacuité de ses congénères, Samuel Perlman se morfond ferme entre son pavillon de banlieue et son appartement parisien. A ses côtés, virevoltent une ex-femme déjà à moitié effacée, une seconde épouse en guerre contre le pessimisme, la méchanceté et la vieillesse et des enfants qu’il ne comprend plus. Des amis aussi, ceux qui n’ont pas encore été fauchés et partagent son même goût pour la mélancolie facétieuse, les attachements inexprimables et le refus de la tempérance à tout-va.
Un mot bête prononcé par sa fille et le monologue commence, lancé au suprême caillou dans sa chaussure, à la dernière épine dans son pied, à son fils, cet « homme heureux« . Voilà le mot, voilà les maux.
» Parlant de ton inaction, de ta non-fertilité, on me dit il est heureux. J’ai mis au monde un type heureux. (…) Heureux, me dit ta soeur. Il a trente-huit ans. Il parcourt le monde avec les trois francs six sous que lui rapporte la location de l’appartement payé par moi. Parcourt le monde, admettons… Je dis: « Qu’est-ce qu’il fait ? Le matin il sort du bungalow. Il regarde la mer. C’est beau. Non, c’est beau, d’accord. Il regarde la mer. Bon. Il est sept heures douze. Il retourne dans le bungalow, il mange une papaye. Il ressort. C’est toujours beau. Il est huit heures treize… Et après ? » Qu’est-ce qui se passe après ? A partir de là tu dois m’expliquer le mot heureux.«
Dans cette lettre engagée autant que résignée, pleine de curiosité et d’humeurs, Samuel Perlman tempête, s’irrite, chuchote, pleure, sourit et se dévoile dans sa complexité de misanthrope attendri et de père désespéré, les yeux pétillants de toutes les émotions qu’il a appris à cultiver dans sa solitude assumée. « On est seul. Mon petit. D’une solitude immense. Totale. Et il n’y a presque pas de lien d’une solitude à une autre. La solitude est longue. Insaisissables sont les allégresses qui nous lient.«
On comprendra que ce vieux-là n’est pas à rencontrer un soir de faiblesse. Car la virtuosité de l’écriture, la sienne, c’est-à-dire celle de Reza, la drôlerie féroce des situations, la grâce des dialogues, vous laissent essoré. Comme Samuel Perlman, on finit sur le carreau, désolé, inconsolable et impatient, riant d’une gaieté funèbre en refermant le livre. Le tyran nous a eus. On veut rentrer dans la vie comme un boulet de canon, on dit adieu aux papayes et aux mots trop simples, on réclame des ciels bas et gris, de l’intolérance aimable et des discussions absurdes. Nos poings serrés, on range le livre en bonne place sur l’étagère de la bibliothèque, pour empoigner autre chose. N’importe quoi. Le cochon d’inde ? Les rideaux ? Sa propre vie ?
Voilà le pouvoir des vieux.
Les vieux sont des monstres.
Philosophe, essayiste et écrivain, Alain Finkielkraut est une voix à part dans le paysage médiatico-culturel français.
Fils de deux orphelins dont les familles furent presque intégralement englouties dans les camps de la mort, Alain Finkielkraut est Juif d’abord et Juif irrévocablement, mais aussi Français, profondément, dans sa culture, dans sa pensée et dans son identité, quoi qu’il arrive.
Il est né à Paris quatre ans après la fin de la seconde guerre mondiale. Son père, Daniel Finkielkraut, maroquinier polonais venu en France dans les années 1930 avec sa famille pour fuir les persécutions antisémites de son pays, tenait une boutique rue Jean-Pierre Timbaud lorsqu’il fut arrêté en 1942, déporté par les autorités française à Drancy d’abord puis directement à Auschwitz, où il survécut trois années durant jusqu’à la Libération. Des membres du clan Finkielkraut, beaucoup ne reviendront pas, parmi eux les grands-parents du philosophe. De l’autre côté, il y a sa mère, Laura avant la guerre puis « Janka » sur les faux papiers qu’elle parvient à se procurer. Un nom qu’elle conservera ensuite, s’étant faite à sa sonorité. Juive polonaise également, Janka restera longtemps cachée en plein coeur du Reich avant de rejoindre finalement la Belgique et plus tard encore la France, mais après la fin du chaos, aucun membre de la famille maternelle ne réapparaîtra. Un engloutissement pur et simple.
Ses parents n’érigent aucun tabou sur leur vécu et le racontent par bribes à leur fils unique, évoquant des visages ou des instants particuliers. Parmi les souvenirs remémorés doucement, il y a celui de ces retrouvailles douloureuses près de l’hôtel Lutetia, dans la cohue de la Victoire. Daniel Finkielkraut, rapatrié d’Auschwitz, tombe sur son frère, qui lui s’était caché en zone libre. « Où sont les parents, demanda Daniel – Ils ont été arrêtés et déportés. Mais ils vont revenir puisque tu es revenu. – Non, ils ne reviendront pas, avait alors murmuré Daniel, les yeux fixes.
Le jeune Alain, rebaptisé Fink sur les registres de l’école élémentaire, moins long, plus français, n’en développe pas moins une fascination romanesque pour ce peuple juif auquel il appartient de fait et aux traumatismes duquel il s’identifie pleinement sans les avoir éprouvés lui-même dans sa chair, comme il commence à en avoir conscience à l’adolescence. Poussé par sa mère, aimante, possessive et très protectrice qui ira jusqu’à rencontrer le proviseur du lycée Henri IV pour le convaincre, son accent polonais roulant sur les mots, d’accepter son brillant enfant dans l’établissement prestigieux, il intégrera, au terme d’une scolarité attentive puis d’une hypokhâgne sérieuse et grave rue Clovis, l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud.
Irrévocablement conscient de sa judéité et attaché à elle par plein choix l’âge adulte franchi, Finkielkraut devient un homme de pensée très engagé qui exclut le confort intellectuel et se refuse à pratiquer les séductions auxquels d’autres succombent lorsque les plateaux télévisés s’allument.
Au cœur de sa réflexion et de ses prises de position, il y a évidemment un attachement puissant aux racines, au devoir de mémoire et au principe de transmission et de responsabilité. Il y a aussi, chargée d’inquiétude et ancrée dans l’actualité, la critique de « la barbarie du monde moderne », celle des comportements et des dérives de la société « vertueuse » et extasiée, celle aussi de la déliquescence des biens républicains : l’école, l’assimilation, le vivre-ensemble. Il devient un « anti-penseur officiel qui prend à rebrousse-poil l’individualisme narcissique des nomades sympas et des déracinés volontaires » (Christian Authier, Alain Finkielkraut ou ce présent qui ne passe pas, mai 2002).
Il enseigne la philosophie à l’Ecole Polytechnique et anime depuis 1985 l’émission « Répliques » sur France Culture.
Ses maîtres à penser sont Hannah Arendt, Charles Péguy, Claude Lévinas et Milan Kundera.
Anecdote : « Je suis allé souvent en Israël je crois qu’Israël est une composante essentielle de la sensibilité juive pour tous. Je n’ai pas eu envie d’y séjourner. Israël a été conçue comme étant le lieu de rassemblement des exilés. Or je sais très bien que la culture française m’a modelé, je suis imprégné par cette langue et par cette culture… Donc si j’allais en Israël par volontarisme, par souci idéologique, je ne mettrais pas fin à mon exil, je créerais là-bas un nouvel exil par rapport à la culture française. » AF, 16 mars 1983, entretien sur Radio Canada.
Oeuvres majeures : Le nouveau désordre amoureux (1977), La défaite de la pensée (1987), Le Juif imaginaire (1982), Comment peut-on être Croate ? (1992)
Extrait, page 99
Un coeur intelligent, d’Alain Finkielkraut (2009)
En parfaite symbiose avec le pathos caractéristique du siècle des situations extrêmes, il [Camus] affirme : « Je me révolte donc nous sommes. » Individuelle dans son essence, la révolte remet pourtant en question la notion même d’individu : « C’est pour toutes les existences en même temps que l’esclave se dresse lorsqu’il juge que, par tel ordre, quelque chose lui est nié… » Par le simple fait d’assigner une limite à l’oppression, la révolte affirme « la dignité commune à tous les hommes ». Elle met au premier rang de ses références « une texture commune, la solidarité de la chaîne, une communication d’être à être qui rend les hommes ressemblants et ligués ». Bref, et pour le dire d’un mot devenu anachronique, l’homme jeté hors de ses gonds par l’inhumanité découvre l’existence d’unenature humaine : « Pourquoi se révolter s’il y a en soi, rien de permanent à préserver ? »
Mais, dit Camus – et c’est tout le sens de la polémique de son livre [L’homme révolté] -, la passion révolutionnaire s’est acharnée contre cette double révélation, par la révolte, de la limite et de la nature. Pour assurer la victoire de l’esclavage insurgé, elle a enjambé sans vergogne la frontière que celui-ci avait voulu tracer. Résultat : elle a constitué le crime en moyen d’action légitime et même en mode de gouvernement. Au nom de la Révolte, la Terreur s »est installée et Staline a mis Spartacus dans un camp de concentration.
Extrait, page 99
La mort d’Ivan Illitch, de Léon Tolstoï (1886)
Il parlait au cheval tout à fait comme on parle aux hommes. Ayant essuyé du pan de son sarrau le dos du cheval, un dos gras marqué au milieu d’une rigole, pelé et poussiéreux, il passa la jeune et jolie tête de l’étalon dans la bride, dégagea les oreilles et la crinière, et le mena boire.
Aussitôt qu’il fut sorti à pas prudents de l’étable remplie de fumier, le Bai se mit à caracoler et à volter, faisant mine de vouloir envoyer une ruade à Nikita, qui l’accompagnait en courant vers le puits.
« Joue un peu pour voir, joue un peu, canaille ! » disait Nikita qui savait bien avec quelle prudence le Bai lançait sa jambe de derrière, non pas pour le frapper mais pour toucher seulement, en manière de jeu, sa pelisse graisseuse, et qui aimait beaucoup cette habitude du cheval.
S’étant abreuvé d’eau glacée, le cheval soupira, agitant ses lèvres fermes toutes mouillées, d’où tombaient dans l’auge des gouttes transparentes ; puis il demeura immobile, comme plongé dans ses réflexions, et soudain s’ébroua bruyamment.
« Tu n’en veux plus, tant pis ! bon, n’en demande plus », dit Nikita, expliquant sa conduite au Bai, très sérieusement et en détail.
Et il repartit en courant vers le hangar, tirant par le licou le jeune cheval tout joyeux qui piaffait et remplissait la cour de bruit.
Tous les serviteurs étaient absents ; il n’y avait dans la cour qu’un étranger, le mari de la cuisinière, venu pour la fête.
« Va lui demander, chère âme, lui dit Nikita, à quel traîneau il faut atteler le cheval : au grand ou bien au petit ? »
Longue nouvelle de l’écrivain russe Léon Tolstoï publiée en 1886, La mort d’Ivan Ilitch raconte la douloureuse et solitaire agonie d’un homme, mais plus encore elle raconte l’histoire de sa vie ratée et de la prise de conscience tardive de ce que celle-ci aurait pu être si elle ne s’était pas façonnée dans l’étroitesse d’un conformisme moral et social empesé et diffus, fourmillant de petits mensonges sans grandeur, de bassesses médiocres et de compromis acceptés.
La nouvelle s’ouvre sur l’enterrement d’Ivan Ilitch, juge d’instruction, fils de fonctionnaire à la carrière que l’on devine tout à la fois exemplaire et banale, et dont ni les anciens collègues de travail, cynique panel de fonctionnaires d’état aux manières policées, ni les proches parents (à commencer par sa veuve Prascovia Fiodorovna et sa fille, fiancée à un bon parti) ne semblent s’émouvoir sincèrement malgré les profondes souffrances qui ont marqué la fin du pauvre homme. C’est à travers le récit de sa vie, en apparence conventionnelle et sans surprise, une vie « des plus simples, des plus ordinaires et des plus atroces », que l’homme se dessine progressivement, terne et bourgeois, et que son étrange agonie prend sens., terminée finalement dans un râle d’acceptation, d’espoir et de libération.
La mort est omniprésente dans la nouvelle. Elle est préfigurée par l’enterrement du personnage, avant de s’annoncer véritablement par la maladie étrange et angoissante qui frappe soudainement Ivan Ilitch dans sa quarante-cinquième année, alors même qu’il semble avoir atteint enfin son idéal de vie et commence à goûter une existence bourgeoise harmonieuse, agréable et facile, sans passion ni combat mais paisible, correcte et approuvée par son milieu.
Le mal pourtant semble insignifiant à ses débuts ; un goût désagréable dans la bouche, un douleur sur le flanc… ces premiers symptômes qui gâtent la bonne humeur du magistrat et viennent mettre à mal l’équilibre fragile de la vie familiale amènent rapidement la consultation de divers médecins, de grands spécialistes impuissants à identifier la cause de ces souffrances sourdes qui bientôt s’accentuent et s’aiguisent sans rémission possible. Ce qui semblait ne devoir être que de passagères incommodités devient dès lors un sujet d’angoisse et une obsession pathologique du magistrat. De l’hypocondrie chronique, Ivan Ilitch passe à une inquiétude, une peur constante et viscérale pour tout son être. Ses repères se brouillent, ses satisfactions sociales et professionnelles s’effacent et disparaissent alors que la maladie, cette maladie dont on ne sait si elle est réelle ou imaginaire finalement, devient le centre de son existence, de ses journées, de son quotidien. La mort se révèle ainsi sous la plume de Léon Tolstoï comme une mort de l’individu social avant d’être une mort du corps.
Mais le mal inconnu a aussi ouvert une brèche dans le monde de certitudes sereines d’Ivan Ilitch et ce personnage sans épaisseur, jusque là marqué par la banalité et la fadeur, devient dès lors un être qui pense, un esprit en perpétuelle interrogation. Son angoisse dépasse le cadre de la maladie. Loin de figer Ivan Ilitch dans la dépression et le dessèchement, elle le bouleverse, elle le transforme et le guide sur un chemin douloureux mais bientôt rédempteur de questionnement et de remise en question.
La mort apparait donc également comme un révélateur intellectuel puissant, un élément perturbateur et rédempteur de l’existence avant que celle-ci ne s’achève.
La perspective de cette mort en suspens confronte en effet Ivan Ilitch à sa vie et le pousse à poser un regard neuf, à défaut d’être critique, sur ses actes, ses choix et ses accomplissements.
Ses relations, sa carrière, sa femme et ses enfants, ses gloires et ses petites joies passées, ses compromis, tout lui apparaît sous un jour nouveau. La plume sobre et omnisciente de Léon Tolstoï pénètre chacune des pensées et des contradictions nouvelles de son personnage, plongeant dans ce qui devient un combat intérieur, éperdu et désespéré. La question n’est alors plus tant de savoir si c’est la maladie qui amène effectivement ce questionnement de toute l’existence d’Ivan Ilitch ou si ce sont ces interrogations contenues en germe dans l’esprit de l’homme et appelées fatalement à se faire entendre qui l’amènent à elle ; l’important devient les réponses que le héros peut trouver à la question « pourquoi ? », « pourquoi mourir » autrement dit finalement « pourquoi vivre » ?
L’agonie étirée sur plusieurs mois d’Ivan Ilitch, ses suspicions, ses révoltes intérieures, deviennent le moyen pour Léon Tolstoï de dresser une critique impitoyable de la médiocrité et du conformisme.
Dans son Journal, l’auteur russe écrivait en 1854 : « Il y a une chose que j’aime plus que le bien : c’est la gloire. Je suis si ambitieux que s’il me fallait choisir entre la gloire et la vertu, je crois bien que je choisirais la première ».
De fait, la médiocrité des ambitions, des joies de bureaucrate et des compromis acceptés par Ivan Ilitch tout au long de sa vie apparaissent très vite. Et si le héros se sent bientôt incapable de supporter les mensonges et les hypocrisies des êtres qui l’entourent et que seuls son fils et le franc et jovial paysan Guérassime ne pratiquent pas (« Le principal tourment d’Ivan Ilitch était le mensonge, ce mensonge admis on ne sait pourquoi par tous, qu’il était malade et non pas mourant et qu’il n’avait qu’à rester calme et se soigner pour que tout s’arrangeât (…) Assez de mensonges ! Vous savez et je sais moi-même que je meurs ! Cessez donc au moins de mentir ! »), ceux-ci s’avèrent précisément le résultat d’une existence vaine et médiocre, confinée dans le besoin moutonnier de l’approbation sociale sans que jamais le magistrat ne voie ni rêve au-delà, dénuée de grandeur et d’éclat, nivelée par la recherche de la bienséance et de la facilité agréable. Ivan Ilitch, dont l’idéal de vie n’aura ainsi été que de se conformer à « ce qui est correct » et de passer agréablement ses jours, comme cela est répété continuellement dans le récit, devine ainsi dans ses derniers mois l’ordinaire pitoyable de sa vie, sans réussir à nommer explicitement la chose, émasculé qu’il reste de sa capacité critique après des années de conformisme insipide et incapable d’imaginer tout d’un coup qu’une liberté de pensée et d’action lui aurait donné un sens.
Ses joies intimes passées, elles-mêmes, perdent soudain de leur réalité devant l’examen auquel il se livre. Car en réalité, Ivan Ilitch a commis la double faute de se satisfaire d’une vie moyenne tout en perdant le sens de l’authenticité, en s’éloignant de sa fragile humanité.
Léon Tosltoï ne critique donc pas seulement la médiocrité mais aussi la vacuité sentimentale et émotionnelle qui menace chacun dans ce modèle de vie. On le comprend particulièrement lorsque revient au magistrat épuisé et perclus de douleurs le souvenir intact et puissant de sa petite enfance, si douce, si sincère et vraie qu’elle lui en arrache des larmes. Cette anecdote nous rappelle le « Rosebud » de Citizen Kane. Ivan Ilitch, tout comme le splendide et solitaire magnat d’Orson Welles, garde pour lui seul cette sensation aigue que ce qui a valu la peine d’être vécu était contenu dans ses jeunes années, simples et joyeuses. L’enfance dans toute sa pureté, l’amour maternel, l’authenticité d’une jeune vie qui n’a pas encore été marquée par le poids des conventions et des calculs apparaissent comme les expressions d’un bonheur infiniment fragile et volatile.
Et seule la mort, ou plutôt l’acceptation laborieuse de sa mortalité (« Caïus est mortel, et il est juste qu’il meure. Mais moi, Vania, Vania Ilitch, avec toutes mes pensées, avec tous mes sentiments, c’est tout autre chose. Et il est impossible que je doive mourir. Ce serait trop affreux. »), permet ici d’en faire prendre conscience. C’est la mort qui permet le retour aux sources. Inéluctable, proche, elle est toute-puissante et impose sa propre échelle de valeur ; elle appelle à l’humilité et à la sincérité la plus absolue, faisant fi des vanités, des mesquineries et des tractations désormais absurdes. Seul compte le sentiment humain authentique qui a été vécu et peut l’être peut-être encore. Celui qui réchauffe, qui reste aussi palpable dans la mémoire qu’une luge ou une assiette de gâteaux préparés par une mère, qui prend la forme de l’espoir, de l’amitié, de la joie et de la complicité.
Il n’est pas facile, à l’heure de sa mort, de reconnaître que sa vie n’a pas été ce qu’elle aurait dû être. Mais Ivan Ilitch, porté de plus en plus intensément par ses souvenirs de vie, rongé par une maladie qui est devenue son dernier et plus intime compagnon, finit par le comprendre : « il lui vint à l’esprit que ce qu’il considérait jusqu’ici comme une impossibilité absolue – c’est-à-dire qu’il eût vécu sa vie autrement qu’il aurait dû le faire – pouvait être la vérité ». Acceptation immensément douloureuse, presque tragique, tout d’abord (« Mais si c’est ainsi, se dit-il, et si je quitte la vie avec le sentiment d’avoir perdu, abîmé toit ce qui m’avait été octroyé, si c’est irréparable, alors quoi ? »), elle apporte enfin la libération et l’apaisement au mourant, bien d’avantage que le prêtre qui le confesse à quelques jours de sa mort ne le fera.
Pour Léon Tolstoï, Dieu ne peut donc ni sauver l’homme ni calmer ses tortures. La rédemption réside dans la vérité seule, et c’est cette même vérité qui offre le salut. Car si Ivan Ilitch perçoit soudain l’absurdité de sa vie, le gâchis qu’il en a fait quand tout aurait pu être si différent, si riche et bon, il n’en conçoit pas moins tout aussi soudainement l’espoir, la conviction, que l’effort n’aura pas été vain. Telle est sa récompense.
On ne sait s’il trouve ce réconfort dans la figure de son fils, seul petit être chez lequel il perçoit sincérité et humanité et qui peut-être saura, lui, éviter les erreurs de son père, ou dans l’idée qu’à défaut d’avoir vécu en homme il meurt en homme. Mais il meurt apaisé, réconcilié dans la vérité. Et Dieu n’y est pour rien.
Les éléments religieux présents dans le roman semblent d’ailleurs participer au mensonge social dans lequel a été si longtemps enfermé Ivan Ilitch. L’enterrement de la scène d’ouverture est le lieu d’expression de l’hypocrisie et des mensonges de son entourage. Le prêtre confesseur disparaît aussi vite qu’il est venu, et le soulagement qu’il procure au mourant se révèle une illusion de plus, qui s’écroule presque aussitôt dans une douleur encore accrue et plus désespérée. Enfin, le dialogue qui rythme toute l’agonie du magistrat est un dialogue avec lui-même, avec sa conscience et ses souvenirs. La figure de Dieu n’est donc nulle part présente tandis que la religion, institution bâtarde des hommes et pétrie de leurs mensonges, s’avère cruelle et fausse. Léon Tolstoï prône donc la liberté intérieure, intime, comme clé du bonheur et comme seul mode de vie susceptible d’épanouir l’homme. La mort arrive une fois cette évidence acquise. La nouvelle s’achève sur le dernier souffle d’Ivan Ilitch, laissant à la mort tout son mystère, insondable sur ce qui vient après, ignorante d’un Paradis ou d’un Enfer, concentrée et tendue toute entière vers ce message qu’Ivan Ilitch transmet et qui apparaissait déjà sur son visage, pendant l’enterrement. L’homme doit rester libre pour toucher au bonheur.
EXTRAIT, PAGE 99
Orages d’acier (1920)
« Le plus beau livre de guerre que j’ai jamais lu » – André Gide
(…) D’abord, tout son repas s’était trouvé fichu et, pour comble de malheur, il avait subi une première dégringolade des plus brutales le long de l’escalier. Il arrivait tout juste de l’arrière et ne s’était pas encore habitué aux rudesses de notre ton.
Après cet intermède, je me rendis dans ma cagna, mais, aujourd’hui encore, je ne devais pas trouver le sommeil réparateur. Dès le petit jour, notre abri fut arrosé de mines, à des intervalles de plus en plus brefs. Vers midi, j’en eus par-dessus la tête. Je mis en batterie avec quelques hommes notre lance-mines Lang et ouvris le feu sur la tranchée adverse – réponse bien faiblarde, il faut l’avouer, aux projectiles lourds dont on nous ratissait. Nous étions occupés, en sueur, sur l’argile d’un petit repli de terrain, recuite par le soleil de juin, à expédier de l’autre côté mine sur mine. Comme les anglais ne semblaient pas sensibles à cette protestation, je me rendis avec Wetje au téléphone, par lequel après réflexion, nous fîmes passer le S.O.S suivant : « Hélène nous crache dans la tranchée, rien que des gros noirs ; il nous faudrait des pommes de terre, des grosses et des petites. » C’était un jargon que nous avions coutume d’employer quand il y avait danger que l’ennemi eût branché une table d’écoute sur notre ligne ; nous reçumes bientôt la réponse consolante du lieutenant Deichmann : le gros brigadier à la moustache conquérante allait arriver en ligne avec quelques gamins. Juste après, notre première mine de cent kilos s’abattit dans un fracas de tonnerre sur la tranchée adverse, suivie de quelques salves d’artillerie de campagne, si bien que nous eûmes la paix le restant du jour.
Mais le lendemain, vers midi, la danse reprit (…)